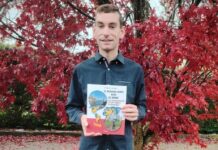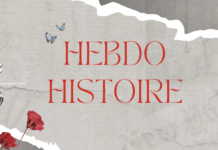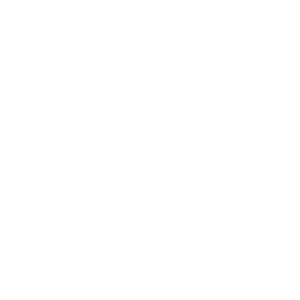Les deux événements inscrivent le pôle Courbet dans une saison placée sous le signe de la nature. Le parcours permanent du musée présente « La Truite » une œuvre majeure du Maître d’Ornans, prêtée par le musée d’Orsay dans le cadre de l’opération nationale « 100 œuvres qui racontent le climat » et la ferme Courbet de Flagey offre aux visiteurs une exposition étonnante « Nuances végétales » d’Hélène Combal-Weiss (jusqu’au 4 janvier 2026).
Le département du Doubs, dans une période budgétaire contrainte, ne fait pas l’économie de la culture. Gustave Courbet (Ornans) et Claude-Nicolas Ledoux (Arc et Senans) en sont la démonstration. Depuis son arrivée à la direction du pôle Courbet, Benjamin Foudral n’a de cesse de casser les codes, à l’image de Gustave Courbet dont il est le gardien majeur et magique.
« Paysages de marche »
« Pour être peint, le paysage doit être éprouvé ». Le peintre Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819) développe le voyage comme préalable à toute peinture de paysage. « …L’artiste doit voyager à petites journées…et le plus souvent à pied ».
Plus de 60 œuvres d’artistes, de Courbet à Renoir, Cézanne ou Millet et l’école de Barbizon, proposent d’explorer ces multiples façons de pérégriner et de concevoir le paysage au XIXe siècle. « A ce moment important de l’art et de l’histoire, l’homme tente de se libérer de la pénibilité de la marche laborieuse et parvient à faire de la lenteur la condition de son art. »
Marcher favorise la connaissance du monde
Pour Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) « voyager à pied, c’est voyager comme Thalès, Platon, Pythagore ».
La pensée, comme le corps, chemine. C’est le propos de Nietzsche (1844-1900) pour qui « seules les pensées qui vous viennent en marchant ont de la valeur ». Gustave Courbet a arpenté dès l’enfance les vallons, grottes, rivières de la campagne franc-comtoise, avant de la peindre. Aristote enseignait en marchant, Courbet peint en marchant !
Une exposition en 8 étapes de marche
« Cheminer »

« Le cheminement est un paysage de traces, celles que l’on suit, celles que l’on fait en marchant ». La peinture emprunte des chemins qui s’ouvrent comme celle d’Alfred Sisley ou bien le chef d’œuvre d’Auguste Renoir « Chemin montant dans les hautes herbes », un prêt exceptionnel du musée d’Orsay.
« Errer »
Prendre le risque de l’errance, la pérégrination sans autre fin. Le peintre a un point de vue à hauteur d’animal sauvage, véritable habitant des lieux. Le paysage réconcilie le corps et l’esprit comme dans « Intérieur de forêt » de Théodore Rousseau (1812-1867), un autre prêt particulier du musée d’Orsay.
« Marcher dans le familier »
La meilleure manière de connaître un territoire est de le parcourir régulièrement à pied. De ce point de vue, Gustave Courbet en est le maître. « Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins…C’est chez moi, cette rivière c’est la Loue, ces rochers…ceux d’Ornans ou du Puits-noir… » disait-il. On trouve cette démarche chez le peintre belge Léon Frédéric (1856-1940) et ses paysages des Ardennes ou chez le jurassien Auguste Pointelin (1839-1933).
« Marcher à la limite »
Quand les grandes villes deviennent capitales d’un monde urbanisé, la marche permet le retour à la nature. Les peintres, souvent citadins, retrouvent la campagne pour « aller sur le motif ». C’est une peinture à la limite entre deux mondes peinte par Georges Michel, Vincent Van Gogh ou Paul Signac. D’un Paris « vu de la campagne », répond une campagne « vue de Paris ».
« La marche laborieuse »
Marcher au XIXe siècle est une activité physique liée au travail. La peinture décrit « des paysages traversés par ceux qui travaillent ». La question sociale est notamment traitée par Jean-François Millet (1814-1875) qui peint le monde gris de ceux qui glanent les restes de la nature comme le bois mort pour se chauffer. Gustave Courbet et « le jeune casseur de cailloux » rend visible le travail des invisibles. Courbet voit dans cet enfant « l’expression la plus complète de la misère ».
« Marcher sur l’histoire »
Au XIXe siècle, certains artistes interpellent sur la pratique moderne de l’archéologie et « ce qu’ils ont sous les pieds de leurs paysages ». Dans le sous-sol du monde, repose l’histoire ! Courbet et Cézanne ont cette intuition que « l’espace est la sédimentation tangible du temps ». Courbet dit son attraction pour la part souterraine du visible quand Cézanne adopte un point de vue au plus près du motif « Pour comprendre la structure cachée du règne minéral, il faut s’y enfouir ». Marcher, c’est vivre et sentir que l’on vit…et apprendre à mourir !
« Marcher dans l’inconnu »

Cette partie de l’exposition est un hommage à Gabriel Loppé (1825-1913), le premier peintre-alpiniste. Témoin et acteur de l’alpiniste, Gabriel Loppé mène une aventure artistique et sportive. Il façonne les paysages de haute montagne faisant des esquisses peintes en altitude, des grands tableaux peints dans son atelier de Chamonix. « L’art devient la récompense de celui qui a mené ses pas jusqu’à l’inconnu ».
« Chambre d’écho ». Eva Jospin à l’atelier Courbet
Depuis sa récente restauration et son ouverture au public, « l’atelier dans la campagne » de Courbet, redevient un lieu dédié à la création et non un musée. Cette année, le pôle Courbet donne une carte blanche à Eva Jospin, une artiste plasticienne renommée internationalement, passée par une résidence à la Villa Medicis à Rome (2016-2017). Diplômée de l’école nationale des Beaux-Arts de Paris, l’artiste de 50 ans est membre de l’Académie des Beaux-Arts depuis 2024.

Elle présente des contre-mondes visibles et invisibles, des forêts, des grottes imaginaires comme une confrontation suivant la trace de Courbet, le peintre marcheur. Elle retient des « sentiments de nature » par des sculptures étonnantes et époustouflantes en carton ou brodées en fil de soie. Une rencontre entre deux univers conjuguant la matière et la forme.
Yves Quemeneur
+ d’infos sur www.musee-courbet.fr